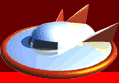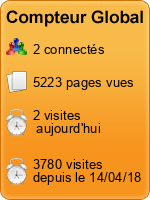14 - Pitcheetoy
Jouets anciens - Antique Toys
Depuis 1970 - Since 1970
Créateur du Salon TOYMANIA
Creator of the PARIS antique toy show
TOYMANIA



DIY
Articles Toys & Dolls
ATTENTION SUR CETTE PAGE PLUSIEURS ARTICLES .... lisez jusqu'au bout de la page
Be careful many articles in this page, slide down to the end of it.
Le Journal du 28 Novembre 1921
LA GUERRE DES JOUETS
C'est incontestablement en ce moment, où la fête des jouets bat son plein, la période de l'année où l'activité commerciale du pays atteint son apogée.
Malheureusement, il est à craindre que de cette activité fiévreuse qui règne aujourd'hui, l'industrie française ne tire pas tout le profit qu'elle mérite ; c'est que, comme l'exposait récemment ici même un de nos collaborateurs, les fabricants français de jouets subissent cette année un rude assaut des fabricants allemands. Ceux-ci, en effet, ont pris nettement l'offensive pour tenter de reconquérir la place si importante qu'ils occupaient avant-guerre dans le commerce des jouets sur le marché français.
Or, il convient de le dire sans plus tarder, si cette tentative réussissait, elle porterait le plus grave préjudice aux petits fabricants français.
Nul n'ignore quavant la guerre, les jeux jouets et autres articles de l'industrie parisienne étaient, pour la plus grande partie, de provenance étrangère.
Cette invasion de produits exotiques, savamment maquillés à la mode française, prenait chaque année une ampleur étonnante, un développement de plus en plus inquiétant. Ainsi, il y a quelque vingt ans, en 1901 , les importations de jeux, jouets et autres articles de bimbeloterie, s'élevaient à 14 000 quintaux . A la veille de la guerre, en 1913 , et après avoir suivi une progression régulièrement constante, les entrées de ces articles en France atteignaient 25 000 quintaux , soit une augmentation de 78 % .
Si l'on se tourne du côté de la bijouterie fausse, de ces articles en aluminium, maillechort, objets dorés et argentés, qui excitaient la faconde du joyeux camelot parisien, on retrouve le même siège, le même accaparement inquiétant du marché français. Alors, en effet, qu'en 1901, les importations d'article de bijouterie fausse s'élevaient à 1 552 quintaux en 1913, elles atteignaient près de 4 000 quintaux , soit une augmentation de 158 % ! Chaque année l'importation étrangère gagnait donc progressivement du terrain sur le marché national.
De tous les pays importateurs de ces articles, l'Allemagne, comme on le devine aisément, tenait le premier rang par l'importance de ces envois. Il convient même d'ajouter qu'au cours des dernières années qui précédèrent la guerre, les expéditions de cette puissance avaient pris un développement considérable. C'est ainsi que, de 1901 à 1913, les envois allemands de jeux, jouets et autres articles de bimbeloterie se sont accrus de 8000 quintaux, soit de 55 %, et que ceux de bijouterie fausse ont augmenté de 1707 quintaux soit de 140 %.
Enfin, on appréciera mieux l'importance de la place qu'occupait avant-guerre l'Allemagne dans l'approvisionnement du marché national en articles de l'industrie parisienne, quand nous aurons dit que les envois allemands représentaient en 1913, les 4/5 des importations totales de ces articles.
On comprendra facilement devant l'effort que font actuellement les allemands pour reconquérir leur place d'avant-guerre dans l'approvisionnement du marché français en jeux, jouets et autres articles de bimbeloterie, l'inquiétude qui se manifeste chez les petits fabricants français. Ceux-ci se voient en effet menacés d'une nouvelle invasion d'articles boches qui constitueront du fait du bas prix de la main d'oeuvre allemande et la dépréciation du mark une concurrence redoutable pour les articles d'origine française.
Espérons, cependant, que quoi qu'il arrive, les papas et les mamans de nos jolis bambins porteront de préférence leur goût sur les articles de fabrication française.LE JOURNAL DU 23 OCTOBRE 1900AU PAYS DES JOUJOUX
Les joujoux sont les héros du jour ; les souliers gagnent d'eux-mêmes les cheminées hospitalières et prometteuses, et le Bonhomme Noël a quitté sa mystérieuse demeure, les bras chargés de pantins et de poupées. Il n'est père, ni mère, oncle ni ami qui n'ait à faire en son esprit une petite place pour les jouets auxquels il faut penser et qu'il serait sacrilège d'oublier.
Donnons une pensée aussi à ceux qui les font, créateurs obscurs de joie pour les tout petits.
En général, l'industrie du jouet est peu connue. Le public ne voit que les détaillants intermédiaires qui sont les magasins de nouveautés, les bazars. Le vrai fabricant reste dissimulé loin derrière, au fond des quartiers du Temple et de Belleville. Il a bien changé depuis la guerre. Avant on disait : les petits fabricants de jouets. Aujourd'hui, ce sont de gros capitalistes, patrons d'énormes usines qui font travailler à Paris 25 000 ouvriers, et grincer des machines, des tours, des engrenages, des moutons, des balanciers. Fini, le pittoresque petit inventeur en chambre. Le jouet est entré dans le mouvement colossal et fiévreux de la grosse industrie , dans la trépidation des affaires d'importance, et il faut une force motrice, des moteurs, des poulies, tout un appareil formidable, pour faire une petite poupée.
Dans le total de notre commerce national, le jouet, à lui seul, représente environ 45 millions d'affaires. Les tableaux des douanes accusent 33 millions d'exportation ; mais ce chiffre est excessif et doit comprendre beaucoup d'articles étrangers en transit et réexpédiés.
Le jouet va ; il irait mieux encore sans l'application des tarifs douaniers de 1892, qui ont fermé les portes de la France aux produits étrangers. Les étrangers se sont vengés en fermant, à leur tour, en verrouillant leurs entrées contre les jouets français.
Les bimbelotiers ont perdu de ce fait une grosse part de leur clientèle.
Le jouet étranger paie, pour entrer en France, 60 fr les 100 kilos.
Le jouet français paie, pour entrer dans les pays étrangers, tantôt 80, ou 100 ou 200, ou 500 francs les 100 kilos . Il n'y a pas réciprocité. Aussi on exporte moins, et le débouché s'est rétréci.
Mais cela va tout de même. Que serait-ce si nos joujoux avaient encore le monde entier pour champ de manoeuvre !
C'est miracle que la situation soit si prospère, étant donné, d'une part, que nous sommes exclus des autres peuples, et que ces peuples - surtout les Allemands - nous inondent de leurs articles.
La chambre syndicale de la corporation des fabricants de jouets et jeux français s'est émue de la trop forte vente des jouets allemands en France.
Elle a déposé, au greffe du tribunal de commerce, une marque française, un triangle , qui doit estampiller toutes les pièces de fabrication nationale :
Des affiches doivent porter cette marque à la connaissance du public, dans les rues, les bazars et les magasins.
Cependant, dans certains magasins et bazars, vous chercherez en vain ce placard vous recommandant la marque nationale ; on y vend trop d'articles allemands. Du moins, le public est-il averti, et si, pour quelques maravédis de moins, il favorise les affaires du commerce allemand, il mérite sa propre exécration.
Mais entrons, par la porte fleurie, enrubannée, verdoyante d'arbres de Noël et étincelante de boules en verre et de minuscules bougies, sur le royaume de Poupinie .
La poupée ! petit rien fait de sciure et de raclure de peau de gants, vêtu d'un délicieux froufrou de mousseline et de satin tendre, enfant de la fillette qui apprend, à la câliner, les douceurs et les caresses de la maternité. Hugo le disait : "le premier enfant continuera la dernière poupée." Et Michelet ne l'a-t-il pas doucement chantée, quand il dépeint la petite fille, grandie, se retirant dans un coin, serrant sur son coeur le poupard à demi cassé, en lui disant tout bas, d'une voix mouillée de pleurs :
- Toi, au moins, tu ne me grondes jamais !
En face de ce tableau attendrissant, mettez celui de l'usine.
Le fracas des machines, le grondement du four, les courroies faisant virer et vibrer les arbres de couche qui agitent les palettes dans les cuves des malaxeurs remplies d'une horrible pâte jaune ; des ouvriers, torse nu, ébranlent la lourde roue du balancier, qui descend et frappe les matrices d'acier ; dans les corbeilles, des portefaix emportent, pêle-mêle, bustes, bras et jambes, luisants de l'huile des moules, gluants encore, comme après un horrible carnage de pygmées. Des paniers sont pleins de petites mains verdâtres ; on se croirait dans la caverne du géant d'Antiverpen.
Une symphonie en rose : c'est l'atelier où les roses jeunes filles colorent les bustes et les membres au sortir de la cuisson. Une chambre noire : ce sont les ouvrières qui, devant la flamme bleue et verte des chalumeaux, tournent les yeux d'émail. Puis, dans le hall vitré, c'est une débauche de toutes les couleurs : c'est l'atelier des décoreuses, qui piquent le rouge aux lèvres et le noir aux sourcils. Le lundi , à cause de la sortie de la veille et de la fatigue, la main tremble et les cils sont moins réguliers.
Voici les coiffeuses, qui frisent le blond thibet et en coiffent les têtes, en piquant la perruque sur la calotte de liège. Les assembleurs réunissent les membres au buste et leur donnent pour rotules des billes de bois. Anatomie conventionnelle.
Il faut aller les trouver tout là-bas, à Montreuil, chez Jumeau , ou à Picpus, rue Montenpoivre , au pied du chemin de fer de Bel-Air.
Ces usines de quatre et cinq cents âmes sont des cités. Ici, la chaussurerie : on coud les petites semelles jaunes aux empeignes mordorés. Là, un raccourci de la rue de la Paix, des fouillis et un froufrou de robes tapageuses, des chapeaux à panaches de plumes : funeste exemple pour les futures petites mamans.
Une scie à vapeur ronfle : elle découpe des liasses de toile de cent à deux cents épaisseurs : chaque patron qui tombe est un lot de chemises toutes prêtes ; il reste qu'à les coller sur le dos de leurs propriétaires.
Dans cet autre hall, des femmes ficellent les bébés par bottes, pieds contre têtes. Les emballeurs mettent en boîtes et en caisses.
Détail particulier à la fabrication parisienne : il n'y a presque plus de fabricants isolés. Ils se sont tous associés en Société anonyme, au capital de quatre millions. Ils sont, à présent, inexpugnables. Ils fabriquent 15 000 poupées par jour , 4 millions et demi de bébés par an !
La poupée est la fée bienfaisante qui fait vivre les malheureux et sourire les tout petits ; elle est la confidente, l'amie, l'enfant chérie. Pour elle, ce n'est pas trop de tant de grosses usines, d'ouvriers, d'ouvrières penchées sur les petits trousseaux et les accessoires de toilette : glaces, ombrelles, brosses, chaînes de montre. Des maisons vivent de la fabrication de ces affiquets.
Un progrès récent. Autrefois, nous achetions nos têtes de porcelaine à l'Allemagne. A présent, ce temps néfaste n'est plus ; nous avons nos fours, nos modeleurs, nos cuves de Kaolin pur de Limoges, - et nous faisons notre tête.
Les poupées ne font point la leur. Ce sont d'exquises personnes, d'un caractère égal, d'une vertu incorruptible, d'une élégance agréable à l'oeil. Elles font vivre des milliers d'ouvriers et d'ouvrières, elles font sourire des milliers d'enfants ; quelle reconnaissance ne leur doit-on pas !
Peut-être méritent-elle un reproche : elles sont trop jolies. Elles sont mises à la mode de demain, il leur faut des bas et souliers rouges, jupons de dentelles, robes de soie à ramages, berthe et manches de dentelle, gants de peau blancs, ombrelle riche ; au front, des frisettes volumineuses d'un blond idéal et introuvable, le grand chapeau de paille rond à larges bords, cavalièrement relevés, avec des plumes abondantes, des noeuds de soie, des piquets de muguet ; au cou, un collier de perles grosses, d'une rondeur et d'un orient délicieux. Et l'on s'étonnera que les jeunes femmes soient coquettes ! Elles ont débuté dans la vie par le mauvais exemple de la poupée !
Mais voici l'armée pesante des soldats de plomb.
Vieux soldats de plomb que nous sommes,
Au cordeau nous alignant tous !
Les soldats de plomb de Béranger ne s'alignent plus guère, et on ne les chante plus. Les couplets de Mam'zelle Nitouche ont été le dernier hommage qu'ils ont reçu. Ils ne sont même plus en plomb, ou à peine. On les fait en feuilles de métal estampées au mouton, puis détourées et soudées.
La concurrence allemande gêne notre fabrication. Le soldat de plomb allemand a un tout autre rôle que les nôtres. Il est édifiant. Il a une mission, qui est d'apprendre aux enfants l'histoire, la géographie, la stratégie, le costume militaire, les plans de batailles célèbres.
Les artistes qui méditent les maquettes sont doublés de savants, d'érudits, qui ne permettent pas une erreur dans le costume du légionnaire de César ou du chasseur alpin. Tout est d'une exactitude rigoureuse. Chaque boîte a un sujet : il y a la boîte des campagnes d'Alexandre, les guerres des Romains, la guerre de Cent Ans ; voici la boîte du siège d'Orléans en 1490, la bataille de Pavie en 1525 ; le bazar devient le Musée de l'armée, et c'est une évocation troublante de panaches, d'uniformes, d'escadrons, de noms sonores ; voici Rosbach, voici Jemmapes, voici Valmy, voici Arcole.
Et voici aussi, pour les petits Allemands, les boîtes funèbres de 70, pour les amuser à refaire nos désastres. Dans les cartons plats, les soldats des deux uniformes dorment comme des morts sur un champ de bataille ; de temps en temps, les enfants d'Allemagne les ressuscitent par manière de divertissement, et selon la boîte, ils refont Wissembourg, Woerth, Gravelotte, Saint-Privat, Bazeilles.
Une brochure avec plans accompagne chaque carton et guide dans ses jeunes le jeune tacticien.
Le Tonkin, Madagascar, la guerre de Chine sont déjà faits et existent dans la série.
Voilà ce qu'ils font, et comment ils le font.
Voilà ce que nous ne savons pas faire.
Nos boîtes de soldats ne sont conçues sur aucun plan et pour aucun but.
Nous perdons ainsi bénévolement une ressource puissante et attrayante pour la cause de l'éducation populaire, un amusement aisé et fécond en résultats, propre à exalter le patriotisme et à inspirer aux petits l'amour et l'orgueil des gloires militaires de la France.
L'allemagne fait une consommation de ces soldats, vendus à la livre, - bien supérieure à celle de notre pays. Non seulement les enfants, mais les officiers et les collectionneurs en prennent une bonne part.
On fait le soldat plat, à deux faces, ou en ronde-bosse ; il est alors plus lourd, plus cher, mais aussi plus artistique.
Paris ne compte que deux grandes fabriques de ce genre ; encore n'en est-il qu'une qui s'en fasse une spécialité. Par contre, Nuremberg et Furth ont conservé la tradition fondée au siècle dernier par le sculpteur Christian Hilpert, expert mouleur de ces figurines militaires d'étain.
Je ne vois qu'un moyen de relever le soldat de plomb en France , c'est d'apporter un peu de méthode à la composition des boîtes , d'y admettre les anciens uniformes du moyen âge, de Louis XIV, de la Révolution, de renouveler ce divertissement monotone de tir aux petits pois en l'illuminant d'une flambée où passerait au galop le cortège de nos batailles et de nos victoires.
LÉO CLARETIELE JOURNAL DU 26 OCTOBRE 1900AU PAYS DES JOUJOUX - 2
Le jouet en métal est la partie la plus importante de cette fabrication et occupe des milliers d'ouvriers, dans de fortes usines où grondent de grosses machines, pour faire des articles infiniment variés : locomotives, wagons, tramways, voitures, fourneaux, ménages, soldats, sujets à volant moteur, personnages estampés, et tous articles divers dont le prie varie de 2 fr 50 la grosse à 125 frs la pièce. Quand on compare le jouet mis entre les mains de l'enfant et l'atelier où il est créé, on est surpris par la disproportion qui sépare l'effort du résultat. C'est la conséquence de la division du travail, qui permet de produire vite et beaucoup.
Aux armes !
Fusils de guerre, fusils de chasse, pistolets, canons, képis, panoplies guerrières, tout cela se fabrique dans la même maison, où de nombreux ouvriers équarrissent les crosses, taillent les lanières de cuir, cousent les galons, coulent du plomb dans les tubes de cuivre pour les courber en clairons et trompettes. On dirait un arsenal en miniature. Il y a même des pistolets dont l'usage est encore inconnu dans l'armée et qui font tourner une toupie quand le coup part. Tout petit Français est déjà un petit soldat. dans tous nos jeunes enfants, il y a un petit tambour d'Arcole qui ne sommeille pas.
La jeunesse de notre pays achète et use pour deux millions de francs en armes et équipements par an. Ils sont tous soldats bien avant le service.
Ils sont, de préférence, cavaliers. On fait beaucoup de chevaux pour eux, chevaux en bois, en carton, en fer, nus ou peaussés, ou drapés. Si on les peausse, c'est-à-dire si on recouvre la carcasse de bois avec une peau appliquée, on préfère la peau de veau. de même, on peausse les éléphants avec de la peau de chamois, et les chameaux avec de la chèvre. Un aimable libre-échange préside à cette répartition.
Si on les drape, on saupoudre avec du drap réduit en poussière leurs flancs enduits de colle molle : métier meurtrier, qui fait vivre les ouvrières drapeuses dans une atmosphère chargée et mortelle, contre laquelle elles se défendent en buvant de grands litres de lait. Il y en a qui en meurent. Le jouet n'est pas toujours gai ; il a ses drames.
Mais quelle joie pour l'enfant d'avoir son cheval, même en bois ! Tout éclopé, il le trouve superbe, fringant, ombrageux, même ; il corrige sévèrement ses écarts ; la pauvre bête a tant reçu de horions qu'elle est tout éborgnée, cabossée, décolorée ; pourtant, l'air demeure fier et hardi, la tête haute sous les caresses comme sous les injures, la patte de devant levée pour un victorieux et irréalisable départ. C'est l'ami de Bébé, qui cause familièrement avec lui comme Achille avec son coursier Xanthos, lui fait honte de ses peurs ombrageuses, et la partie de cheval se termine ordinairement par une dégelée de coups qui renverse, les quatre roues en l'air, la plus noble conquête que l'homme ait jamais faite.
A côté de ces jouets, qu'il faut pousser pour qu'ils marchent, il y a ceux qui marchent tout seuls.
Vaucanson est dépassé . L'ingéniosité et la science de nos fabricants d'automates sont admirables, et l'on fait, aujourd'hui, pour vingt-neuf sous, de petits sujets, comme ils disent, "mouvementés" , tels qu'un prince héritier de jadis n'eût pu en posséder de semblables. Des centaines d'ouvrières assemblent des roues dentées, des pignons, des tiges, et la division du travail est telle que la même ouvrière n'a autre chose à faire toute la sainte journée qu'à poser un point de soudure sur la même partie d'un assemblage. Et, par milliers par jour, sortent de là de petits personnages de fer costumés d'étoffes : un violoniste, un livreur, un cireur, une portière, un poivrot, un agent des voitures, un Boxer, un Boer ; et tout ce petit monde s'agite, se remue, brandit des épées, des balais, des bouteilles, et fait consciencieusement, jusqu'à la fin de son existence, la tâche pour laquelle chacun est né. Quel exemple pour la société ! Jamais le violoniste n'essaiera de faire la lessive de la blanchisseuse, sa voisine ; chacun reste dans sa sphère, et tout marche. Ce microcosme devrait être le modèle des peuples.
Quant aux automates de luxe, ils sont surprenants. Beaucoup de gymnasiarques : ce sont eux qui font le plus de mouvements avec leur corps ; ils sont donc des exemplaires tout indiqués pour des faiseurs de poupées animées. Un acrobate fait des manoeuvres savantes autour d'un trapèze ; un hercule fait des poids. Ou Bien c'est une scène : Madame s'habille pour aller au bal, et, comme toutes les femmes, n'en finit pas ; Monsieur, en habit, debout près de la cheminée, lit le journal, s'impatiente, éteint la lumière ; Madame trépigne, et, comme toujours, Monsieur cède, et rallume. Quels observateurs, quels psychologues que ces fabricants ! Combien vont flâner par les rues, l'appareil photographique en bandoulière, attentifs aux types, aux scènes ! Et ils écrivent, avec leurs bonshommes, la vie parisienne pour les érudits de l'avenir, qui se pencheront sur les vitrines des expositions rétrospectives futures.
Que n'obtient-on pas de l'automate ! Il fume, il rejette la fumée, il brûle sa cigarette jusqu'au mégot, il trempe une paille dans un bol d'eau de savon, la porte à ses lèvres, souffle, enfle une bulle, la lance et voilà dans les airs.
La vagabonde où brille l'univers.
Les automates ! c'est le coin des jolies étoffes pimpantes, claires, gaies, de tons à chauds à l'oeil, de losanges bleu pâle, rose tendre, à franges d'or, avec des pompons, des rubans, des boutons dorés, des noeuds de soie, des fleurs ; c'est la grâce, le sourire, la coquetterie des marottes, des folies, des oiseaux chanteurs dans des cages d'or.
Impossible d'exporter ces articles . Ils paient à l'étranger, en droit d'entrée, comme si leur poids total représentait ce volume de soie ou de satin, c'est-à-dire 4 ou 500 francs les 100 kilos. Le métier est difficile. il faut du nouveau, de la variété ! Et le secret du système à garder ! Et la contrefaçon !
Tout cela, c'est le jouet monté en grand, la fabrication de conséquence. Voulons-nous voir les derniers petits bimbelotiers ? Ils sont dans le carton-pâte.
Du côté de Ménilmontant, passage Julien-Lacroix ou rue Eupatoria . Un petit jardinet à treillage de bois précède la maison. Au rez-de-chaussée, dans la chambre basse, le petit poêle-marmite échauffe la buée en suspension dans l'air. Il règne une odeur fade et âcre de colle et de carton détrempé. Sur la table de bois blanc, toute la famille travaille : la fille remue dans le seau de colle du vieux-papier d'emballage ramassé dans le sous-sol des magasins et qui tombe en bouillie verdâtre ; la mère enduit de graisse le creux des matrices d'acier où le père bourre et tamponne, avec un manche de bois, le carton-pâte amolli. On démonte : les moitiés de pièces apparaissent, d'un jaune sale et huileux, qui feront des quilles, des masques, des chevaux, des soldats, des Boers, des Krugers, des Chinois, des Russes, des Chamberlains pour jeux de quilles. On soude ces moitiés gluantes ; sur des claies, elles sèchent, près du petit poêle-marmite ; pis, le fils de la maison les colorie, et, le samedi, on porte le panier plein chez le patron pour renouveler la provision d'ouvrage.
Ainsi se font aussi les pupazzi , les marionnettes des guignols et théâtres puérils.
Théâtres d'enfants ! Petits guignols traditionnels et charmants. Rien n'a changé depuis l'ancien régime. Les décors sont en forme de périactes, comme sur les scènes de la Foire Saint-Laurent ou de la Foire Saint-Germain. On se croirait à la Comédie italienne, quand on jouait du Gherardi. Les petits acteurs en carton moulé sont de vieilles connaissances, et les filles de Louis XV jouaient avec eux. Voyez-les, ficelés en bottes, qui accompagnent le monument. Les vieux types ont persisté dans cette petite province de l'art dramatique. Le théâtre pour enfant n'a eu ni son Diderot, ni son Saurin, ni son Beaumarchais. Il est vrai de dire qu'il n'a même pas eu son Campistron, et que la littérature dramatique puérile n'existe qu'à l'état d'inepties blanches.
Comme au vieux temps, sur les panneaux décoratifs que peignent et collent les ouvriers en théâtres enfantins, là-bas, près des Buttes-Chaumont, c'est toujours, dans un décor à la Watteau, Pierrot qui dénonce à Cassandre le perfide Arlequin courtisant Colombine. On se croirait aux meilleurs jours de Fuzelier, de d'Orneval et de Lesage.
Nommez les acteurs dans la botte de Pupazzi qui accompagne chaque théâtre : c'est Pierrot, Arlequin, Cassandre, le Docteur, Trivelin, Colombine, avec la Fée nuagée de tuelle, le vieux Marquis et la Marquise accorte de Sedaine, le Juge tout de rouge habillé, le Garde-Français moustachu, le Marié, l'Accordée du village, Gros-Blaise : il semble qu'ils vont entrer en scène pour jouer Le Déserteur ou la Fête au village voisin ou le Valet de Chambre de Carafa, ou Annette et Lubin, ou le répertoire de Dominique et de Romagnesi.
Le théâtre enfantin est comme le théâtre des grands . Il traverse une crise. Il ne fait ni progrès ni embellissements. les jeunes gens font à présent du sport et de la bicyclette, et ils méprisent l'art scénique en chambre.
Il n'en va pas de même en Allemagne. Là, ce sont des fêtes de famille, que les représentations théâtrales puériles. Ah ! les jolis décors, et variés, et savants et pittoresques ! Chez nous, un théâtre bien monté à trois décors : un est collé sur le carton du fond ; les deux autres sont collés sur les deux faces d'un carton mobile. Ils représentent un salon, un parc et une forêt. Avec cela, on joue tout le répertoire.
Les décors allemands sont plus variés et plus artistiques. Ce sont un temple égyptien savamment documenté, une forêt vierge aux lianes entrelacées, un intérieur de château-fort moyen âge, une nef de cathédrale, un paysage alpestre et romantique, avec de petites rainures perforées : en mettant une bougie derrière, on voit les rayons de la lune scintiller dans les branches et se refléter dans les rides du lac.
Les petits Allemands sont évidemment plus exigeants, plus scéniques que les nôtres.
Chez nous, les tout petits s'amusent suffisamment avec cette sorte de boîte conventionnelle qui coûte quelques francs et qu'on appelle Théâtre par approximation : quatre planchettes, deux coulisses, un rideau, une baguette figurant la rampe ; de la salle il n'est jamais question : l'enfant qui joue au théâtre est toujours censé faire salle comble, puisque le public, c'est lui, et que, comme Léandre des Plaideurs, il fait l'assemblée.
C'est un détail infini que celui des différentes spécialités que comporte cette industrie : voitures pour enfants, voitures pour les poupées, et dans ce genre classez les bicyclettes, les tricycles, les automobiles de toutes marques : les instruments de musique, qui sont des diminutifs très soignés et très justes de ton, car nous ne sommes plus au temps où l'on pouvait rire des petites musiques enfantines ; l'enfant n'entre plus dans la vie sur une fausse note ; les cornemuses, flagolets, ocarinas, mirlitons, bigophones, les boîtes en cartonnage où sont si joliment disposés les accessoires de couture, de tapisserie, de mercerie, d'épicerie, de jeux divers ; la variété imposante des jouets scientifiques qui mettent le petit garçon au -dessus des connaissances paternelles et ajoutent à son vocabulaire des termes techniques d'une érudition alarmante, quand on l'entend demander à sa bonne, pour jouer, son plénakisticope, son zootrope, son gyroscope, son lampascope, son métallophone, sa boîte d'électrostatique, son accumulateur, ses réactifs, son hyposulfite, sa bobine de Rühmkorff, ses tubes de Geissler ou sa machine de Winshurst.
Le caoutchouc, la baudruche, se plient à toutes les formes des moules pour se fournir d'animaux et de ballons ; les ébénistes se plient aux exigences de mesdemoiselles les poupées, qui faisant fi du mobilier de leurs mères, n'admettent déjà plus que le meuble modern-style .
Encore n'avons-nous pas énuméré les articles de sport, agrès, jeux de jardin, billes, montres d'enfants, oeufs de Pâques, farces, attrapes, poisson d'avril, masques, articles de cotillon, confetti, serpentins. Voyez combien de milliers d'articles, quel labeur et quelle fièvre, étant donné que, pendant toute l'année, on les demande peu, et qu'il faut tout faire en deux ou trois mois pour la Noël, la Saint-Nicolas et le jour de l'An !
On peut juger par là de l'activité laborieuse de cette sympathique laborieuse de cette sympathique corporation qui lutte vaillamment contre la concurrence allemande. Aussi, aidez-les, achetez ce qu'ils font, ne secondez pas l'étranger dans ses ruses et ses subterfuges pour se substituer à nos fabricants sur notre propre marché. Le jouet parisien garde sa supériorité artistique de bibelot spirituel et gracieux ; vous irez à lui, car vous ne voudrez pas faire tort à la fois et à votre bon goût et à votre patriotisme.
LÉO CLARETIELE JOURNAL DU 16 octobre 1901
POUPÉES D'ACADÉMICIENS ET DE SOUVERAINSM. le préfet de police vient d'organiser un concours de modèles de jouets d'enfants, principalement de poupées. Il n'a pas voulu que, seuls, les fabricants y présentassent des projets, et il a prié quatre membres de l'Académie des beaux-arts, MM Gérome, Edouard Detaille, Frémiet et Coutant de lui envoyer, pour l'exposition qu'il fera à cette occasion, quelqu'oeuvre de leur composition pour leur plus grand avantage et celui des bébés à qui on les donnera.
Comme nous l'avons dit, hier, M. Gêrome a exécuté une petite statuette du genre de celles de Tanagra ; c'est une petite femme grecque, la tunique flottante, qui elle-même est une marchande ambulante de poupées ; elle porte un éventaire où sont accumulées des quantités de poupées microscopiques, achetées par M. Gérôme, dans des bazars parisiens, et elle fait l'article en montrant une de ces poupées qu'elle tient à la main. Cette dernière poupée, pour flatter M. Lépine, est un sergent de ville, son bâton blanc à la main.
M. Detaille a fait une figure découpée sur une planche, représentant d'un côté un chasseur alpin et de l'autre un chasseur de la garde impériale russe.
M. Frémiet a modelé en cire un singe qui vient de mettre le pied dans le pot au feu et en retire une tête de coq, ce qui l'effraie et le met en fureur ; ce singe sera exécuté en bois et peint avec les bras mobiles.
M. Coutant n'a pas encore commencé son modèle, qui ne doit pas être, du reste, envoyé avant le 20 de ce mois, mais il projette de modeler deux patineuses valsant sur la glace.
Les poupées et les jouets ont le don d'amuser grands et petits et les académiciens ne sont pas seuls à en avoir fait. La reine Victoria en avait habillé un grand nombre dans sa jeunesse.
En octobre 1892 , on retrouva dans un grenier de Buckingham-Palace une centaine de ces poupées,compagnes de jeux de la reine quelques soixante-dix auparavant.
Lorsque, la vieille souveraine apprit cette découverte, elle fit apporter immédiatement ses vieux souvenirs d'enfance à Osborne, dans l'Ile de Wight, où elle se trouvait.
Elles n'étaient guère jolies, cependant, ces vulgaires poupées de bois fabriquées à Nuremberg, peintes d'un vermillon brutal sur les joues, les sourcils faits d'un coup de pinceau de noir de cirage.
Ce sont des portraits soi-disant, dont la reine a fait elle-même les habits.
Celle-ci, c'est Ernestine, la vachère suisse de Balmoral ; cette autre, c'est le maître de danse de la future impératrice des Indes ; puis viennent les dames de sa société, miss Pool et Lady Brighton. Mais c'était surtout au sortir du spectacle, lorsque la jeune princesse avait vu les ballets de Kenilworth, Sleeping Beauty, l'anneau magique, la Bayadère, la Sylphide, que, l'imagination montée par les splendeurs de la mise en scène, elle s'appliquait à reproduire les costumes des principales actrices. Plus de quatre fois elle a fait la Taglioni ; elle a représenté aussi M. Musard, Célestine, qui devint plus tard Lady Lenox, et Sylvie Leconte, depuis princesse Poniatowska. Si les figures des poupées sont plutôt ridicules, les costumes sont d'une exécution délicate, il y a tel mouchoir de quatre centimètres carrés qui est brodé aux armes et aux chiffres de la dame qui le tient à la main.
La reine a voulu consacrer la mémoire de ces chers souvenirs en quelques pages qu'elle a envoyées à un magazine de Londres.
Que sont devenus ces joujoux, depuis sa mort ? Nous ne le savons pas, mais l'on devrait bien les garder sous les vitrines dans quelque musée où la foule se précipiterait pour les voir.
L'empereur Nicolas , comme la reine Victoria, confectionnait aussi des poupées ; à défaut de Detaille, qui n'était pas encore né, il prenait Horace Vernet comme collaborateur. En 1836, il lui faisait dessiner les costumes de tous les corps de l'armée russe et lui-même corrigeait l'oeuvre du peintre de la barrière de Clichy.
Les fantassins font le maniement d'armes. Les cavaliers sont au trot, le sabre au poing.
Chacune de ces statuettes au quart de la grandeur naturelle, admirablement coloriées, sont encore conservées dans le cabinet de travail de l'empereur Nicolas II, à Tsarkoé-Sélo. Elles sont sur de grandes vitrines, qui couvrent les murs jusqu'au haut, et sur chaque rayon on voit, comme dans une revue, tous les types du soldat russe de 1840 . Énorme shako en pot de fleurs, avec non moins énorme plumet, col raide, manche étroite, pantalon à sous-pieds... voici les géants Préobajensky ; voici les Pawloski, au nez en l'air et à la tiare de cuivre...
L'empereur Napoléon III eut aussi une collection de poupées militaires , dont M. Frémiet , l'un des élus du concours actuel, était l'auteur.
Par une nuit d'hiver, passant dans la cour du Carrousel, devant le Palais des Tuileries, éclairé par un bal, M. Frémiet fut frappé de l'allure d'un canonnier à cheval et d'un guide qui montaient la garde devant le petit arc de triomphe. Au milieu de la place couverte de neige, leurs silhouettes se détachaient en noir sur le sol blanc : le grand manteau et la carabine au poing, ils semblaient l'évocation de leurs anciens, de ceux de la vieille garde.
M. Frémiet commença par reproduire les deux visions qu'il avait eues.
L'empereur l'ayant appris, lui demanda de faire la série de toutes les troupes de l'armée française ; seulement, l'empereur désirait que chaque statuette fut exécutée au naturel, c'est-à-dire que le drap devait être fait de la poudre du drap réel de l'uniforme, avec les passe-poils et les galons, les talpacks seraient exécutés avec de la soie floche réduite en hachis, les barnais avec de la peau de vieux gants.
Les statuettes faites, leurs armes miniatures furent commandées aux ateliers de précision du Comité d'artillerie ; enfin, pour indiquer la précision des détails, même les plus imperceptibles, nous dirons que, sur les boutons, d'un millimètre de diamètre, on distinguait l'aigle impérial.
De 1855 à 1865, M. frémiet fit 70 figures qui venaient se placer dans une vitrine des Tuileries.
Un jour le jeune prince impérial jouait avec son camarade Fleury, aujourd'hui l'historien des maîtresse de Louis XV. Les deux jeunes gens prirent les petits soldats pour leur faire livrer une bataille ; et, dans la bataille, quelques-uns des combattants furent blessés. Heureusement que M. Frémiet, en habile chirurgien, pansa les blessures. Mais les malheureux soldats étaient voués à la destruction ; ils furent brûlés dans l'incendie des Tuileries, en mai 1871 .
Heureusement, quelques-unes de ces statuettes - une douzaine - avaient été coulées en bronze et leur modèle a été sauvé. Exécutées pour pouvoir être reproduites en grand, il serait à souhaiter que l'État en fit fondre deux, à grande échelle, elles formeraient deux cariatides superbe à la porte du musée de l'armée.
GERMAIN BAPST.
LE JOURNAL DU 16 octobre 1901
POUPÉES D'ACADÉMICIENS ET DE SOUVERAINS
M. le préfet de police vient d'organiser un concours de modèles de jouets d'enfants, principalement de poupées. Il n'a pas voulu que, seuls, les fabricants y présentassent des projets, et il a prié quatre membres de l'Académie des beaux-arts, MM Gérome, Edouard Detaille, Frémiet et Coutant de lui envoyer, pour l'exposition qu'il fera à cette occasion, quelqu'oeuvre de leur composition pour leur plus grand avantage et celui des bébés à qui on les donnera.
Comme nous l'avons dit, hier, M. Gêrome a exécuté une petite statuette du genre de celles de Tanagra ; c'est une petite femme grecque, la tunique flottante, qui elle-même est une marchande ambulante de poupées ; elle porte un éventaire où sont accumulées des quantités de poupées microscopiques, achetées par M. Gérôme, dans des bazars parisiens, et elle fait l'article en montrant une de ces poupées qu'elle tient à la main. Cette dernière poupée, pour flatter M. Lépine, est un sergent de ville, son bâton blanc à la main.
M. Detaille a fait une figure découpée sur une planche, représentant d'un côté un chasseur alpin et de l'autre un chasseur de la garde impériale russe.
M. Frémiet a modelé en cire un singe qui vient de mettre le pied dans le pot au feu et en retire une tête de coq, ce qui l'effraie et le met en fureur ; ce singe sera exécuté en bois et peint avec les bras mobiles.M. Coutant n'a pas encore commencé son modèle, qui ne doit pas être, du reste, envoyé avant le 20 de ce mois, mais il projette de modeler deux patineuses valsant sur la glace.
Les poupées et les jouets ont le don d'amuser grands et petits et les académiciens ne sont pas seuls à en avoir fait. La reine Victoria en avait habillé un grand nombre dans sa jeunesse.
En octobre 1892 , on retrouva dans un grenier de Buckingham-Palace une centaine de ces poupées,compagnes de jeux de la reine quelques soixante-dix auparavant.
Lorsque, la vieille souveraine apprit cette découverte, elle fit apporter immédiatement ses vieux souvenirs d'enfance à Osborne, dans l'Ile de Wight, où elle se trouvait.
Elles n'étaient guère jolies, cependant, ces vulgaires poupées de bois fabriquées à Nuremberg, peintes d'un vermillon brutal sur les joues, les sourcils faits d'un coup de pinceau de noir de cirage.
Ce sont des portraits soi-disant, dont la reine a fait elle-même les habits.
Celle-ci, c'est Ernestine, la vachère suisse de Balmoral ; cette autre, c'est le maître de danse de la future impératrice des Indes ; puis viennent les dames de sa société, miss Pool et Lady Brighton. Mais c'était surtout au sortir du spectacle, lorsque la jeune princesse avait vu les ballets de Kenilworth, Sleeping Beauty, l'anneau magique, la Bayadère, la Sylphide, que, l'imagination montée par les splendeurs de la mise en scène, elle s'appliquait à reproduire les costumes des principales actrices. Plus de quatre fois elle a fait la Taglioni ; elle a représenté aussi M. Musard, Célestine, qui devint plus tard Lady Lenox, et Sylvie Leconte, depuis princesse Poniatowska. Si les figures des poupées sont plutôt ridicules, les costumes sont d'une exécution délicate, il y a tel mouchoir de quatre centimètres carrés qui est brodé aux armes et aux chiffres de la dame qui le tient à la main.
La reine a voulu consacrer la mémoire de ces chers souvenirs en quelques pages qu'elle a envoyées à un magazine de Londres.
Que sont devenus ces joujoux, depuis sa mort ? Nous ne le savons pas, mais l'on devrait bien les garder sous les vitrines dans quelque musée où la foule se précipiterait pour les voir.
L'empereur Nicolas , comme la reine Victoria, confectionnait aussi des poupées ; à défaut de Detaille, qui n'était pas encore né, il prenait Horace Vernet comme collaborateur. En 1836, il lui faisait dessiner les costumes de tous les corps de l'armée russe et lui-même corrigeait l'oeuvre du peintre de la barrière de Clichy.
Les fantassins font le maniement d'armes. Les cavaliers sont au trot, le sabre au poing.
Chacune de ces statuettes au quart de la grandeur naturelle, admirablement coloriées, sont encore conservées dans le cabinet de travail de l'empereur Nicolas II, à Tsarkoé-Sélo. Elles sont sur de grandes vitrines, qui couvrent les murs jusqu'au haut, et sur chaque rayon on voit, comme dans une revue, tous les types du soldat russe de 1840 . Énorme shako en pot de fleurs, avec non moins énorme plumet, col raide, manche étroite, pantalon à sous-pieds... voici les géants Préobajensky ; voici les Pawloski, au nez en l'air et à la tiare de cuivre...
L'empereur Napoléon III eut aussi une collection de poupées militaires , dont M. Frémiet , l'un des élus du concours actuel, était l'auteur.
Par une nuit d'hiver, passant dans la cour du Carrousel, devant le Palais des Tuileries, éclairé par un bal, M. Frémiet fut frappé de l'allure d'un canonnier à cheval et d'un guide qui montaient la garde devant le petit arc de triomphe. Au milieu de la place couverte de neige, leurs silhouettes se détachaient en noir sur le sol blanc : le grand manteau et la carabine au poing, ils semblaient l'évocation de leurs anciens, de ceux de la vieille garde.
M. Frémiet commença par reproduire les deux visions qu'il avait eues.
L'empereur l'ayant appris, lui demanda de faire la série de toutes les troupes de l'armée française ; seulement, l'empereur désirait que chaque statuette fut exécutée au naturel, c'est-à-dire que le drap devait être fait de la poudre du drap réel de l'uniforme, avec les passe-poils et les galons, les talpacks seraient exécutés avec de la soie floche réduite en hachis, les barnais avec de la peau de vieux gants.
Les statuettes faites, leurs armes miniatures furent commandées aux ateliers de précision du Comité d'artillerie ; enfin, pour indiquer la précision des détails, même les plus imperceptibles, nous dirons que, sur les boutons, d'un millimètre de diamètre, on distinguait l'aigle impérial.
De 1855 à 1865, M. frémiet fit 70 figures qui venaient se placer dans une vitrine des Tuileries.
Un jour le jeune prince impérial jouait avec son camarade Fleury, aujourd'hui l'historien des maîtresse de Louis XV. Les deux jeunes gens prirent les petits soldats pour leur faire livrer une bataille ; et, dans la bataille, quelques-uns des combattants furent blessés. Heureusement que M. Frémiet, en habile chirurgien, pansa les blessures. Mais les malheureux soldats étaient voués à la destruction ; ils furent brûlés dans l'incendie des Tuileries, en mai 1871 .
Heureusement, quelques-unes de ces statuettes - une douzaine - avaient été coulées en bronze et leur modèle a été sauvé. Exécutées pour pouvoir être reproduites en grand, il serait à souhaiter que l'État en fit fondre deux, à grande échelle, elles formeraient deux cariatides superbe à la porte du musée de l'armée.
GERMAIN BAPST.Supplément littéraire du Petit ParisienVOYAGE AU PAYS DES JOUJOUX"Ma tête, ma pauvre tête !" s'écriait un personnage de comédie.
J'aurais presque le droit de pousser la même exclamation douloureuse, car, depuis hier, j'ai sous le crâne toutes sortes de visions et de vacarmes : chiens qui aboient, agneaux qui bêlent, ânes qui braient, vaches qui beuglent, sarabandes de polichinelles aux accords d'un orchestre étrange composé de lapins battant la caisse, des chevaux au galop, des fantassins à l'exercice, puis un formidable bruit de vaisselle, comme si du haut de quelque escalier du palais dégringolaient tous les chaudrons et toutes les casseroles de la cuisine de Gargantua, et quand je crois que c'est fini, des voitures roulent, des canons tressautent sur leur essieu, des bateaux à vapeur font évoluer leur hélice, et, derrière une locomotive qui halète et qui souffle, un train de chemin de fer, avec mille figures immobiles aux portières, s'allonge fantastiquement.
Voici ce qui s'est passé :
Un camarade, ancien commissionnaire en marchandises et fort au courant de ce qui concerne "l'article de Paris, me dit l'autre matin :
- Le jour de l'An approche, les fabricants de jouets sont dans le coup de feu des expéditions ; le moment serait venu, puisque tu as cette envie depuis longtemps, d'aller leur faire une visite.
Je le suivis rue Taille-Pain , je le suivis rue Pierre-au-Lars , je le suivis rue Brise-Miche (on aurait pu aussi bien prendre tout droit par la rue Saint-Martin ou la rue du Temple , mais mon ami a la coquetterie des chemins de traverse où personne, excepté lui, ne passe plus guère) ; puis, ayant contourné le chevet gothique et noir de Saint-Merri, l'intervalle des maisons s'élargit peu à peu et nous nous trouvâmes au milieu d'un carrefour où flottait dans l'air ce parfum spécial, cher à l'enfance, du sapin frais scié et du fer-blanc nouvellement verni. A tous les étalages, sur les enseignes, des trompettes et des tambours, des sabres de bois, des pistolets de paille, des polichinelles gigantesques, une barre de fer dans le dos, découpaient sur l'azur du ciel leur profil joyeux et bizarre, et dans la cour des vieux hôtels jadis habités par les présidents, de grands camions attelés et chargés s'apprêtaient à emporter en province et jusqu'au bout du monde leur cargaison d'innocente joie : la poupée d'un sou, rudimentaire et raide, qui paraît si belle aux yeux ouverts tout ronds, du petit paysan, et le pantin à grelots d'or, vêtu de satin et de cannetille, dont s'amusera un seul jour le caprice des enfants riches.
Nous étions arrivés au Pays des Joujoux !
Chemin faisant, mon guide m'expliquait, à grand renfort de considérations économiques et de chiffres, les diverses branches de cette industrie, les jouets en fer et en bois, les pièces habillées, les pièces à effet pour étalages, les meubles, les animaux vernis, ceux couverts de laine et de poils, sur soufflets, roulettes et galets, les soldats de plomb, les imitations mécaniques.
- C'est tout un monde !
Comme nous passions rue Chapon :
- Montons ici, je dois connaître le patron.
Il le connaissait en effet : M. Georges Potier , un homme aimable qui, sur l'assurance que je n'étais pas un concurrent, se mit gracieusement à notre disposition pour nous faire voir en détail les coins et recoins de sa manufacture.
M. Potier fabrique de tout avec le fer-blanc , des casernes et des cuisines, des écuries et des salons, des tramways, des bateaux, des chemins de fer. Il n'est pas d'objet usuel, il n'est pas création raffinée dont on ne retrouve chez lui la représentation exacte et minuscule. Notre civilisation peut périr : rien qu'avec une boutique de marchand de joujoux, les savants pourront la reconstituer tout entière ; et si tant de détails précieux de la vie romaine et grecque nous échappent, si l'on en est encore à se demander comment les anciens repassaient leurs mouchoirs, comment les catapultes marchaient et de quelle façon se plaçaient les rameurs sur les galères à trois rangs de rames, c'est que, dans les laves d'Herculanum et sous les cendres de Pompéi, la fatalité a voulu qu'on n'ait pas découvert encore la boutique d'un marchand de joujoux !
Mais que d'efforts humains, quel outillage il faut pour produire cette chose pourtant si fragile ! Voici les machines à estamper, les découpoirs, les ateliers pour la soudure et la fonte peuplés d'ouvriers noirs comme des Cyclopes, tenant à la main des fers à chalumeau activités par l'air comprimé, et soufflant bruyamment la flamme, ou bien assis autour d'une chaudière en fusion et faisant ruisseler par grandes cuillerées l'étain fondu, éblouissant et lourd comme une cascade d'argent vif. Ailleurs, le métal grince, des roues tournent, une fine limaille de cuivre, pareille à la poudre d'or que vendent les nègres en Guinée, couvre de luisants établis. C'est ici que se fabriquent les pièces mécaniques. Puis, quand tout est ajusté, monté, viennent le décor, le vernissage, le bronzage, le séchage au four ; après quoi, il ne restera plus qu'à mettre le jouet parfait dans sa boîte, une de ces boîtes en bois blanc et mince que les enfants connaissent bien et qu'ils ouvrent avec tant d'émotion, sûrs qu'ils sont de les trouver pleines de merveilles.
Ce travail occupe près de deux cents ouvrières et ouvriers.
Avant de nous quitter, M. Portier nous dit :
- Vous savez, tout ce que j'emploie ici est d'origine française, et je vais vous montrer ce que je considère comme mon triomphe.
C'étaient de petits soldats de plomb qu'une vieille femme rangeait par douzaines ; ils avaient le casque pointu, le costume prussien.
- Vous ne comprenez pas ? C'est pourtant bien simple. Avant la guerre, les soldats de plomb nous venaient d'Allemagne ; maintenant, c'est moi qui leur expédie à Berlin !
Et nous nous sérrâmes la main patriotiquement, réjouis à l'idée de cette pacifique revanche.
- Qui diable invente toutes ces choses ?
- Un peu tout le monde, les patrons, les ouvriers. Chacun, au courant de l'année, a sa trouvaille, son idée. Et puis, il y a les petits fabricants qui travaillent en chambre et qui cèdent leurs brevets aux gros bonnets. Ce sont les plus intéressants ; mais ils habitent surtout Ménilmontant et le haut de Belleville , et nous n'aurions pas le temps de les voir aujourd'hui.
Cependant, ce petit monde d'étain et de fer m'avait un peu fatigué. J'éprouvais le besoin de me reposer à des spectacles plus rustiques. Tout à coup, rue des Archives , une enseigne m'arrêta : "Maison Schanne , - fondée en 1817, - animaux, laines et poils, bergeries et écuries fines".
- Mais c'est mon vieux Schanne, cela ! Schanne le musicien, compagnon d'aventures de Mürger et de Champfleury. Pour tout dire, en un mot, le Schaunard de la Vie de Bohème, aujourd'hui bourgeois de Paris et commerçant notable.
L'atelier de Schanne est une idylle , et Théocrite s'y plairait : des chiens, des moutons, des ânes, des vaches, des chèvres ! Les murs résonnent d'échos bucoliques ; dès la porte, on se sent devenir berger. Schanne modèle lui-même ses sujets en cire, ce qui exige un art tout particulier. Il faut traiter l'animal en écorché, pour qu'une fois la toison, si c'est un mouton, le veau mort-né, si c'est un cheval ou une vache, ajustés et collés sur le moulage en carton, on sente par-dessous la saillie des os et le jeu des muscles.
Schanne conserve pour son musée des pièces d'une vérité parfaite, d'une spirituelle observation. C'est qu'en se faisant industriel, il a su demeurer artiste. Dans un petit salon où s'escrime contre les barreaux de sa cage en osier une magnifique alouette huppée, - l'oiseau gaulois ! sont les souvenirs de la verte jeunesse : des croquis au mur, des portraits d'amis, le piano sur lequel, aux heures de loisir, on compose encore.
Mais dans l'âme de Schanne, c'est le jouet qui, décidément tient la plus grande place. Schanne a sur le jouet tout une esthétique et toute une philosophie que Schaunard ne renierait point. Il nous disait :
- L'enfant naît bon et doux ; qu'aime-t-il ? que demande-t-il ? Des chiens, des moutons qui sont bons et doux comme lui . Il ne veut pas d'animaux féroces. j'ai essayé un jour de fabriquer des lions et des tigres, mais je n'en ai pas vendu un seul. L'humanité vaut mieux qu'on ne croit ; le jouet m'a réconcilié avec elle !
Et sur cette pensée consolante, nous quittâmes le royaume des joujoux.
Un poète s'est demandé ce que devenaient les vieilles lunes ; on peut, par une curiosité aussi juste, se demander ce que deviennent les vieux jouets.
- Mais quoi ! les joujoux ne vieillissent point. Aimés des enfants, ils meurent jeunes comme les héros aimés des Dieux. Offert ce soir tout flambant neuf, le bébé mécanique frisé d'or aura demain pour tête une boule informe décolorée sous les baisers ; la poupée parlante, ni plus ni moins qu'un martyr chrétien ses entrailles, laissera le son et la sciure couler de son ventre fait de fine peau de gant ; et le cheval de carton qu'un imprudent palefrenier aura trop souvent mené boire se trouvera fondu jusqu'au cou. Les joujoux sont d'essence éphémère, et, dès la semaine après le Jour de l'An, on peut chercher ce qui survit d'eux dans d'étranges Champs-Elysées où vont, paraît-il, les âmes des choses cassées, en compagnie des débris du vase en cristal à, qui l'empereur Héliogabale, spiritualiste raffiné, fit élever un grand tombeau.
Aussi n'est-ce pas le joujou acheté, donné, mis en morceaux, dont le sort nous inquiète. Celui-là suit sa destinée ! Mais bien le joujou invendu.
Car tous les joujoux ne se vendent pas dans ces baraques improvisées qui, huit ou quinze jours durant, donnent un air de rue chinoise aux trottoirs de nos boulevards.
Où vont les pantins démodés, les "articles-Paris" vieillis, les "succès de l'année" dont l'impertinente brume d'hiver a flétri le clinquant et ramolli la cannetille ? Peut-être, expédiés aux Grandes-Indes et vers de lointaines Polynésies , charmeront-ils quelque jeune prince négrillon dont le père se pare, en guise d'ornement guerrier, d'une éblouissante boîte à sardines ! Peut-être aussi, fourrés dans les coins, empilés dans des caisses, relégués dans la chambre aux soldes au fond d'entrepôts ténébreux, connaîtront-ils, jusqu'à ce que les mites en aient raison, l'existence mélancolique des marchandises passées à l'état de "rossignols" !
Eh bien ! non : toute gloire a son regain comme la bonne herbe, et j'ai découvert hier, en me promenant, que ces riens charmants, qu'une fois défraîchis le Paris riche et boulevardier méprise, ne sont pas perdus pour cela.
Loin des quartiers riches, tout près des fortifications, au-delà des anciennes barrières, le long des larges avenues aux maisons rares traversant le Paris suburbain, il y a aussi des baraques à joujoux - moins somptueuses, moins illuminées, mais non moins achalandées, certes ! et perpétuellement entourés, tant que le jour dure ou que le gaz n'est pas éteint, d'un cercle de gamins peu vêtus dont les yeux s'allument de convoitise.
C'est là que les joujoux de l'an passé redeviennent joujoux à la mode. Que dis-je ? les joujoux de l'an passé ! les joujoux d'il y a dix ans, d'il y a vingt ans ! Promenade à faire pour ceux que tente l'amère douceur des mélancolies rétrospectives.
Essayez-en ! et, tout émus, vous retrouverez votre enfance en retrouvant les joujoux primitifs comme en donnaient jadis les grands-pères. Joujoux barbares, violents, crevant les yeux, poissant aux doigts et sentant bon la térébenthine. Longues trompettes en fer-blanc emplâtrait un doigt de soudure ; tambours cerclés de cuivre luisant ; petits violons rouges dont même l'art infernal d'un Paganini n'aurait pas su tirer une note ; poupées en bois, les bras tombants, les jambes jointes, roides comme des statues, petits soldats, fabriqués au tour et portant encore le grand shako des premières guerres d'Afrique, vaillants forgerons battant l'enclume et faits d'un rondin surmonté d'une boule, à qui un morceau de bois incisé donne l'apparence du profil humain ; et ces étonnants animaux dus à la collaboration de sculpteurs sans raison et de coloristes en délire. Chevaux indigo, taureaux écarlates, lions faits en peau de lapin, lapins ornés d'une crinière à qui les oreilles redressées et deux clous d'or en guise d'yeux donnent un aspect diabolique !
Et qu'on ne s'y trompe pas : nos grands-pères avaient raison ! Ce sont bien là les vrais joujoux. Ces joujoux, les enfants les aiment, et non vos joujoux plus nature que la nature, et faux à force de réalité, qu'on met à la mode aujourd'hui.
J'en avais acheté un hier, -à très bon marché, - pour ne pas revenir sans rien. Qu'était-ce ? je l'ignore. Un monstre ! Quelque chose qui prétendait être un cheval et qui aurait pu tout aussi bien se réclamer de la parenté de l'hippopotame. Un être effrayant, ou plutôt une ébauche d'être, taillé à la hache, sauvagement colorié, ambigu, bizarre, né du chaos, tel qu'en ont déterré les paléontologistes.
Comme je le portais sous le bras, les passants se retournaient pour en rire.
Eh bien ! mon petit ami Toto, qui n'a pas ses quatre ans, l'a tout de suite reconnu ; - Toto, en le voyant s'est écrié :
- c'est un âne !
Et il a dédaigneusement jeté par terre un autre âne qu'il avait déjà, un âne en carton-pâte, exact comme un croquis d'artiste, avec le poil curieusement imité par un semis de laine hachée et les tendons saillants sous la peau.
Évidemment, Toto avait raison : mon âne, - l'âne idéal, - était le vrai âne !
Mais que voulez-vous ? partageant le sort de tous mes contemporains, l'oeil perverti, le sens esthétique dépravé par un précoce abus d'habitudes naturalistes, je ne m'en étais pas aperçu.
PAUL ARENE
L'INDUSTRIE DE LA POUPÉE
Article de la Revue Universelle - Léo Claretie 1903
Rubrique ( Sciences morales et politiques )
Comme les fabricants de métal les fabricants de poupées se sont réunis en société.
Il n'y a pour ainsi dire plus qu'une seule fabrique de poupées à Paris, et il reste fort peu de maisons, en dehors de la forte association: Société générale et anonyme du bébé français. Celle-ci a englobé et réuni les fabriques principales et fait les deux tiers des poupées en France. Elle en fait pour 4 millions de francs, à raison de 15 000 poupées par jour, soit 4 500 000 bébés par an. Elle a ses usines un peu partout, à Montreuil, à Picpus, rue Montempoivre, à Bel-Air. Elle fabrique tous les genres, « luxe » et « courant », pâte et porcelaine. Depuis quelques années elle n'est plus tributaire de l'Allemagne pour les têtes de porcelaine; elle a un four, ce qui lui permet de faire sa tête.
Une poupée riche, cliquez sur la photo pour l'obtenir plein écran.
La famille des poupées comporte une infinie variété d'espèces; dans ce petit monde comme dans le grand, règne la plus douloureuse inégalité, beaucoup plus brutalement marquée encore que dans la vie, ou le pauvre a deux pieds et deux mains comme le riche. En Poupinie, la pauvrette a pour bras deux bouts d'allumettes et regarde d'un Ïil d'envie les bras de soie bourrée de son qui embellissent sa sÏur enrichie. La pauvre est en bois ou en pâte très peu poétiquement pétrie dans les malaxeurs à vapeur, une pâte brune et écÏurante faite de sciure, de gomme adragante, de raclure de peau de gants. Une fois moulée sous l'estampeuse à vapeur et séchée à l'étuve, cette pâte devient dure et incassable comme pierre. On cache sa vilaine teinte verdâtre sous de belles couleurs sauce crevette; deux points` noirs ou bleus font les yeux; un point rouge cerise marque les lèvres. Notez que l'ouvrière qui peint les yeux bleus est payée plus cher que celle qui peint les yeux noirs; elle a OfrO3 à la douzaine; l'autre n'a que OfrO2, parce que le bleu « coule » plus. Les blondes aux yeux bleus seront fières d'apprendre cet avantage. La peinture des cils est un travail délicat; il s'agit de tracer des petites parallèles: en semaine cela va bien; mais le lundi, l'ouvrière est fatiguée par sa sortie du dimanche; sa main tremble. Les Cils du Lundi ne valent rien.
La poupée de la classe supérieure a des articulations en billes aux épaules, aux coudes, aux hanches et aux genoux; elle a une tête cuite au feu, pur kaolin, moulée comme chez Jumeau, sur des modèles copiés au Louvre. Les têtes se cuisent par centaines, mises au feu sur des plateaux ronds appelés « Gazette ».
Quand la poupée riche, celle qui coûtera 8, 10, 15 ou 20 francs, est munie de ses membres articulés et de sa tête, il ne lui manque plus que deux accessoires assez utiles, des cheveux et des yeux. Les cheveux sont des écheveaux frisés du Tibet, collés sur une peau, et celle-ci est délicatement fixée avec de petits clous sur le crâne de liège. Quant aux yeux, ils sont faits artistement à l'usine, dans des chambres noires, par des ouvrières verrières qui travaillent dans l'ombre avec des chalumeaux. Elles font de très jolis yeux. Ce sont des artistes; elles gagnent 6 francs par jour, salaire très élevé pour des femmes.
Il circule dans ces fabriques d'étranges corbeilles, avant le rassemblement, des corbeilles pleines de mains menues, de jambes, d'yeux. On songe à des massacres d'innocents.
L'inégalité sociale pèse sur la poupée; elle regarde différemment, selon son rang. Simple bourgeoise, elle a l'Ïil fixe, collé à l'orbite par une touche de cire à bougie; le regard est immobile. Plus fortunée, elle peut lever les yeux au ciel. Riche et parvenue, elle peut en outre les tourner de côté, en coulisse, grâce à de petits contrepoids de plomb cachés derrière son nez. La fortune a ses caprices et ses faveurs.
L'industrie de la poupée &emdash; et je ne parle pas des petites mignonnettes fabriquées dans les prisons par les mains calleuses des détenus &emdash; comporté une annexe importante, l'habillage. Mlle Lili a ses ateliers, ses magasins, sa lingerie, ses chemises découpées à la cisaille à vapeur en trois cents épaisseurs à la fois, ses souliers, collés ou cousus selon le prix, ses robes d'un chic très parisien, trop élégant même pour donner à sa petite mère des goûts de simplicité et de modestie, ses chapeaux volumineux et d'assez mauvais genre, d'un luxe tapageur et qui pourrait faire croire à de biens mauvaises fréquentations. Ajoutez les parures, bijoux de chrysocale, ombrelles, laces trousses, montres, elle a tout ce qu'il faut. L'atelier de l'habillage et garniture ressemble à une prolongation de la rue de la Paix.
Voilà prête la moderne Pandore. On la couche dans une belle boîte et la voilà partie en camion ou en wagon par le monde qu'elle émerveillera, et où elle aura le sort de toutes les créatures; elle y sera aimée, parée, grondée, battue, cassée et remplacée; elle connaîtra la vie.
Les robots
Yves TANIOU
Robby le fameux robot du film "Planète interdite"
L'histoire du robot-jouet est étroitement liée a celle du jouet japonais d'après-guerre, du moins en ce qui concerne les robots en tôle emboutie (les plus collectionnés) fabriqués entre le début des années cinquante et la fin des années soixante. En effet, ces robots-jouets sont de fabrication japonaise à 95 %. Quand on sait que plusieurs centaines de ces modèles différents ont vu le jour (robots et jouets de l'espace additionnés) et que d'autre part les robots ne sont qu'un des thèmes parmi des dizaines d'autres que les japonais exploitèrent comme créneau de fabrication, on mesure l'ampleur que pouvait avoir l'industrie du Jouet au Japon au lendemain de la 2e guerre mondiale et ce pendant une vingtaine d'années.
La collection se divise en fait en quatre thèmes spécifiques:
- les robots
- Les astronautes
- Les jouets de l'espace
- Les supers héros.
Nos robots et astronautes sont animés - soit par un moteur mécanique (wind-up) soit par un moteur électrique (battery operated) certains plus sophistiqués sont téléguidés (remote control).
Le premier robot recensé s'appelle « LILIPUT» (marque: KT) fabriqué au Japon entre 1940 et 1942 il mesure 16 cm et un ingénieux système d'ergots qui sortent alternativement de ses « jambes » lui permet d'avancer en lui donnant une démarche très appropriée, son aspect très naïf et sa rareté en font une pièce très convoitée des collectionneurs.
Chronologiquement le second se nomme « ATOMIC ROBOT » et fonctionne sur le même principe que le précédent, il mesure 13 cm et date des années 1946-1948. Quoique pas trop rare c'est à juste titre un grand classique très apprécié.
Citons également deux robots « ancêtres» non-japonais du tout début des années cinquante le « NANDO» (marque: O.P.S.E.T.) nous vient d'Italie, il mesure 12cm et c'est une poire actionnant une membrane caoutchouc qui le fait avancer tourner la tête.
L'autre est allemand et mesure 19 cm, il est intéressant de noter la ressemblance existant entre ce robot allemand et son homologue japonais « le MECHANICAL BRAIN » (marque ALPS) légèrement postérieur. Ce dernier a d'ailleurs la particularité d'avoir un moteur mécanique pour avancer et une pile dans la tête qui permet aux ampoules remplaçant ses mains de s'allumer. Après ces quelques « ancêtres» passons aux modèles de la fin des années cinquante, plus grands, plus riches en couleurs et en lithographies bien souvent électriques et donc plus sophistiqués. C'est le cas du « MECHANIZED ROBOT » (marque: SHOWA) en fait le célèbre « ROBBY » plus connu dans le jargon des collectionneurs sous le nom de « grand Robby. (bien sûr à cause de sa taille de 34 cm) qui fut fabriqué après la sortie du film de Science fiction américain « Planète interdite». C'est à mon avis l'époque la plus riche où les plus beaux robots furent fabriqués (1958-1963). On peut d'ailleurs remarquer que le même moule servit à la fabrication de différents modèles, c'est le cas du « grand Robby» dont le moule du corps fut utilisé pour deux autres jouets: « le Grand Astronaute» au talkie Walkie et le « Iron man» (dessin animé japonais). A propos de l'as- tronaute au talkie walkie, je pense que c'est le plus beau modèle d'astronaute fabriqué, il existe en deux couleurs, rouge et bleu également dans une version sans talkie-walkie et avec un visage enfantin. Il va sans dire que c'est un « must très recherché Robby le héros de «Planète interdite» a beaucoup inspiré les fabricants japonais puisqu'une bonne douzaine de jouets différents ont été conçus en s'inspirant directement de ce personnage mais sans jamais mentionner le nom de ROBBY sur le jouet ou sur sa boîte pour ne pas avoir à payer de droits de reproduction. On était encore loin des sévères contrôles de Stephen Spielberg pour son « E.T.».
Néanmoins un jouet représentant Robby sur son char de l'espace (très fidèle par rapport au film) mentionne le nom sur chaque côté du jouet. C'est le « ROBBY SPACE PATROL». Toutes les pièces à l'effigie de ROBBY sont bien sûr très collectionnée. mais c'est sans aucun doute le « ROBBY SPACE PATROL» le plus rare et le plus convoité.
D'autres belles pièces de grande taille tel que le « SMOCKING SPACE MAN » (Marque: Linemar) de 30 cm qui illustre la couverture du livre de Pierre Boogaerts « ce ROBOT existe en gris métallisé et en bleu. « L'ASTRONAUTE » Cragstan de 35 cm avec sa mitraillette et ses pieds plats existe en rouge et en bleu ainsi qu'une version avec une tête en caoutchouc particulièrement laide.
Il y a également ceux que l'on appelle les « GRANDS ROBES ,., « Grands » (26 cm) et « Robes » parce qu'ils n'ont pas de jambes. Ces robots de toute beauté sont parmi les plus recherchés, il en existe cinq variantes aux décors différents.
Robby space patrol, 2 MisterAtomic , 4 grands jupes ou robes
Avant de conclure, quelques mots sur un robot qui fait beaucoup parler de lui, le fameux « MISTER ATOMIC» (marque: Cragstan) haut de 28 cm. De tous les robots-jouets c'est le MISTER ATOMIC avec son cri d'oiseau et ses nombreuses ampoules que les collectionneurs ont élu comme vedette. On en connaît tous un, qui dort dans un grenier, et sommes tous prêts à monter une expédition pour aller le récupérer. Il existe en bleu et en gris-argent ainsi qu'en marron clair paraît-il ?
Pour finir quelques conseils: les robots sont devenus des jouets de collection à part entière donc plus question de les trouver pour rien chez les marchands .
Les robots sont présents dans toutes les bourses de jouets (toy-show) à travers le monde.
Essayez aussi les marchés aux puces et les foires à la brocante tout en sachant que la France a été très peu fournie en robots par rapport à la Belgique ou à l'Italie par exemple. Sachez également que beaucoup de collectionneurs de robots se connaissent et qu'il est donc facile de faire des échanges. Enfin, et c'est le plus important, fiez-vous à votre goût et à vos impressions. Chaque collection a ses particularités et ses pièces fétiches.
Sur ce, je vous souhaite plein de belles découvertes.
Yves TANIOU.
web site : www.borobo.com